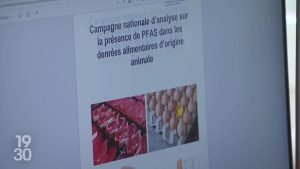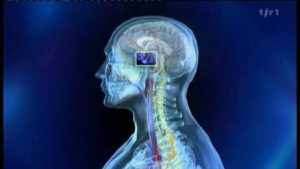Autodiagnostic en santé mentale sur les réseaux sociaux : risques, limites et conseils d’experts

Autodiagnostic en santé mentale sur les réseaux sociaux : risques et limites
Dans une vidéo publiée sur TikTok, l’auteur évoque les trois grands types de TDAH, dont le type inattentif sans hyperactivité, et décrit des difficultés de concentration. Le propos illustre une pratique où des symptômes observés en ligne servent d’élément d’autodiagnostic et où le lecteur est invité à partager ces observations sur les réseaux, un phénomène qui prend de l’ampleur.
La question est complexe : si certains estiment que ce type de témoignages peut favoriser la discussion et la sensibilisation, des spécialistes avertissent des limites et des risques associés à ce phénomène.
Selon Joël Billieux, professeur de psychologie clinique et d’évaluation psychologique à l’Université de Lausanne, ce type de contenus peut déstigmatiser ces troubles et offrir un effet miroir, mais il peut aussi favoriser un biais de confirmation, c’est-à-dire sélectionner l’information qui colle avec ce que l’on cherche à vérifier sans tenir compte des éléments qui contredisent l’hypothèse.
Fausse information et risques de faux positifs
Le principal risque réside dans un autodiagnostic erroné. L’autodiagnostic peut conduire à des faux positifs : on peut croire souffrir d’un trouble alors qu’il s’agit simplement d’une difficulté occasionnelle de concentration, sans autre atteinte. Une étude menée cet été par l’Université de Montréal, sur un échantillon de 1000 vidéos consacrées à la santé mentale sur TikTok, a montré qu’une publication sur cinq contenait des informations fausses.
Si l’on se pense atteint d’un trouble, on peut chercher des traitements inadaptés ou se tourner vers des outils en ligne qui ne sont pas nécessairement validés scientifiquement ou délivrés par des professionnels. Ces solutions ne constituent pas des démarches scientifiquement établies.
« Imaginer qu’on peut se diagnostiquer avec un auto-questionnaire, c’est quelque chose qui n’est absolument pas réaliste sur le plan médical », résume Joël Billieux, professeur à l’Université de Lausanne.
Des influenceurs pourraient proposer des approches similaires, notamment autour de l’alimentation, ce qui peut aggraver des problématiques telles que l’anorexie et conduire à des effets néfastes sur la santé.
Pour le trouble de l’attention, certains internautes déduisent arbitrairement qu’ils ne parviennent pas à suivre le rythme des autres et réduisent leurs efforts sans que cela ne soit réellement examiné par un professionnel.
Plusieurs entretiens nécessaires
Joël Billieux rappelle le risque d’adhérer à des idées fausses sur son fonctionnement, ce qui peut retarder une prise en charge adaptée. Une évaluation professionnelle comporte bien plus que de simples tests en ligne.
Le recours à des professionnels implique l’obtention d’informations auprès des proches, enseignants et parents, ainsi que l’utilisation de méthodes d’évaluation complémentaires. Le processus nécessite souvent un à trois entretiens à différents moments pour vérifier la stabilité d’un éventuel trouble.
Si l’on remplit soi-même une échelle d’auto-évaluation sur la concentration, les habitudes d’attention ou l’interruption des échanges, il peut être tentant de répondre « oui » à de nombreux items et de conclure à tort à l’existence d’un trouble, alors que ces éléments ne constituent qu’une partie du diagnostic.
Selon l’expert, nous vivons dans une société qui a tendance à pathologiser les différences individuelles.
Il précise que la prise en charge professionnelle se fonde sur des informations variées et l’obtention de retours d’entourage, notamment des enseignants et des parents, et que l’évaluation s’appuie sur d’autres méthodes, avec souvent plusieurs entretiens pour confirmer la stabilité d’un éventuel trouble.
Tendance à tout étiqueter
Joël Billieux rappelle qu’un diagnostic fondé sur un auto-questionnaire n’est pas une réalité médicale, même s’il peut servir d’indicateur incitant à consulter. Une telle pratique ne doit pas devenir une finalité en soi.
La multiplication des autodiagnostics reflète, selon l’expert, une tendance sociétale à catégoriser les différences individuelles. Il invite à distinguer un trouble psychiatrique des variations de personnalité ou des styles d’apprentissage, en rappelant qu’un trouble se caractérise par un dysfonctionnement dans la vie quotidienne et une souffrance psychologique.