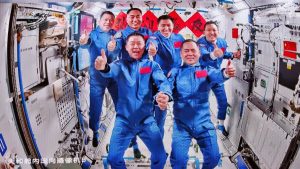L’influence humaine sur l’évolution de la taille des animaux : une étude historique

Uneanalyse longue durée de l’évolution animale
Selon Allowen Evin, bioarchéologue à l’Institut des sciences de l’évolution de Montpellier, c’est en comparant l’évolution de la taille des animaux domestiques et sauvages que l’on peut mieux comprendre l’impact croissant de l’action humaine depuis environ un millénaire. Cette recherche, menée par le CNRS et financée par le Conseil européen de la recherche, s’appuie sur l’étude de fossiles osseux issus de la région méditerranéenne en France.
Une méthodologie centrée sur une zone géographique restreinte
Les chercheurs ont choisi de concentrer leur analyse sur une zone géographique limitée afin d’éviter les variations dues à des facteurs environnementaux ou culturels importants. L’étude débute il y a environ 8000 ans, avec l’arrivée des premières sociétés d’éleveurs et d’agriculteurs dans cette région. Cette approche temporelle étendue permet d’observer des tendances sur plusieurs millénaires.
Une évolution synchronisée jusqu’à il y a un millénaire
Durant les 7000 premières années, les populations animales sauvages, telles que le cerf, le lièvre ou le renard, évoluaient en parallèle avec les espèces domestiques comme le mouton, la chèvre, le cochon, la vache ou la poule. En grande partie, l’environnement semblait jouer un rôle déterminant dans ces changements, avec peu d’écarts notables entre les deux groupes.
Une mutation à l’échelle humaine il y a environ 1000 ans
Cependant, il y a environ un millénaire, un changement significatif s’opère. La bioarchéologue souligne qu’au cours de cette période, toutes les espèces domestiques commencent à augmenter de taille, alors que les animaux sauvages voient leur taille diminuer. Ce tournant témoigne probablement d’une influence accrue de l’intervention humaine dans ces processus évolutifs.
Les facteurs expliquant cette divergence
Les hypothèses avancées pour expliquer cette évolution divergent selon le groupe animal. Concernant les espèces domestiques, l’intensification de la sélection par l’homme, alliée à des pratiques agricoles et d’élevage axées sur une productivité croissante, pourrait avoir favorisé cette tendance à l’augmentation de taille. Pour les animaux sauvages, la réduction de leur habitat naturel, due à une déforestation voire une pression accrue de la chasse, pourrait expliquer leur décroissance en taille, en lien avec une disponibilité moindre d’habitats favorables.
Ce constat souligne donc que l’impact de l’homme sur la taille des animaux est particulièrement marqué à partir du dernier millénaire, en lien avec l’adoption de pratiques agricoles et de gestion de la faune de plus en plus intensives. La confrontation de ces données offre une perspective précieuse sur l’histoire des interactions entre l’humanité et le règne animal.