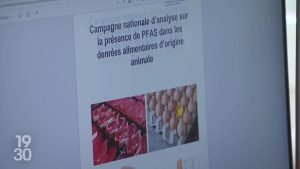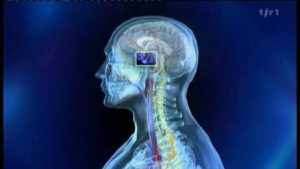Prix des médicaments : tensions entre industrie pharmaceutique et régulateurs, enjeux d’innovation et de financement
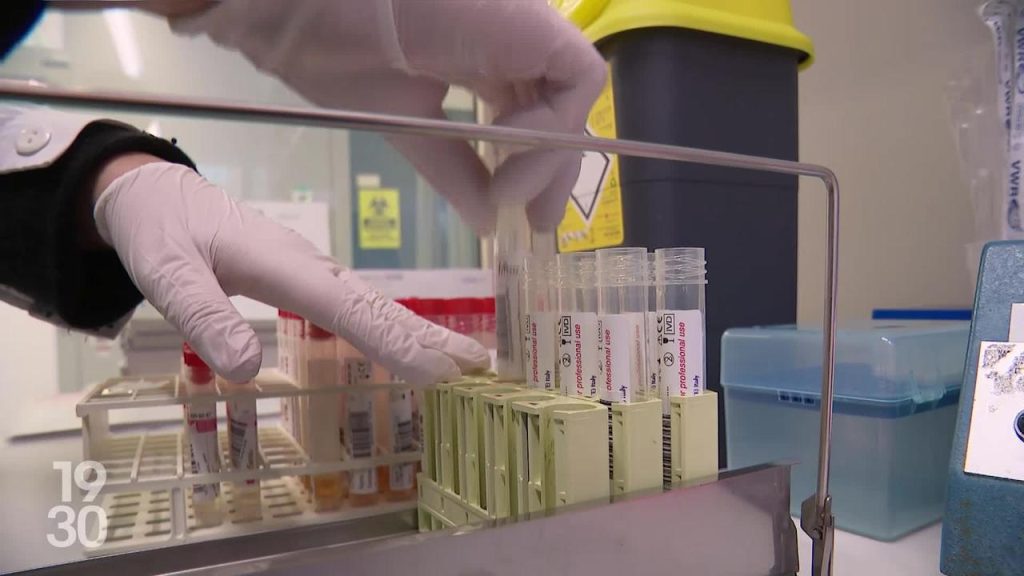
Conflit croissant sur les tarifs des traitements
Les rapports entre les entreprises pharmaceutiques et les autorités de régulation s’enveniment à l’échelle mondiale à propos des tarifs des nouveaux médicaments. D’un côté, les laboratoires estiment que l’innovation n’est pas suffisamment rétribuée ; de l’autre, les autorités sanitaires craignent une hausse des coûts des traitements innovants dans un contexte de pression politique et budgétaire croissante.
Contexte international et mesures américaines
La situation est partiellement alimentée par des initiatives politiques telles que celles émanant des États‑Unis. En mai, un décret présidentiel vise à aligner les prix des médicaments les plus élevés du pays sur les niveaux les plus bas observés dans des pays dont le PIB par habitant atteint au moins 60 % du niveau américain. Le texte appelle également les pays européens à financer davantage les coûts de l’innovation.
Des coûts et chiffres marquants
Les dépenses liées aux traitements anticancéreux ont progressé de 75 % sur les cinq dernières années, atteignant 252 milliards de dollars en 2024, selon IQVIA. Dans des domaines comme le cancer ou les maladies rares, le nombre de traitements disponibles s’accroît, mais les prix restent élevés afin de financer leur développement clinique.
Roche a précisé que le développement d’un nouveau traitement nécessite environ dix ans de travail et un investissement de 5,5 milliards de francs, et que, en pratique, seulement environ 10 % des candidats arrivés en phase d’essais cliniques aboutissent à une commercialisation.
Remises et opacité des accords
Des pays comme l’Italie, l’Espagne et la France exigent désormais des remises et rabais de la part des fabricants pour obtenir des prix plus bas et un accès plus rapide aux traitements. Les laboratoires acceptent ces accords sous condition de confidentialité, arguant que le secret empêche d’autres pays d’exiger des prix plus bas que leurs voisins. Ces pratiques en coulisses ont conduit à une référence internationale des prix largement trompeuse.
Selon l’économiste de la santé Thomas Hofmarcher, la situation perdure depuis au moins deux décennies.
Désaccords, retards et accès aux soins
Face à l’impossibilité perçue de réduire les coûts, les États demandent des justifications plus solides des prix. Presque chaque pays européen dispose aujourd’hui d’une agence d’évaluation des technologies de santé (HTA) qui analyse non seulement les effets médicaux, mais aussi les dimensions sociales, éthiques et économiques des médicaments. Dans ce contexte de négociations de plus en plus ardues, l’accès aux traitements nouvellement approuvés peut se retrouver retardé ou limité. En Europe, seulement 29 % des traitements approuvés au cours des trois années précédant 2024 étaient accessibles via les mécanismes de remboursement centralisés, contre 42 % en 2019, selon l’étude W.A.I.T. menée par la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques.
Certains médicaments largement répandus aux États‑Unis ont toutefois été jugés non rentables par certains régulateurs européens, comme Legembi ou Enhertu. En juillet, Roche a retiré son traitement Lunsumio du marché suisse après que les autorités ont exigé davantage de preuves pour parvenir à un prix définitif.
Conclusion
À ce stade, aucune solution claire ne se dégage pour la fixation des prix, et les observateurs estiment que les appels de Washington à des tarifs plus élevés dans d’autres pays pourraient accroître les tensions. Les systèmes de santé européens, largement dépendants de l’État, peinent à supporter une augmentation des coûts.