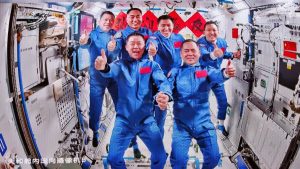Il y a trente ans, la première exoplanète découverte bouleversait l’astronomie
Contexte historique et remise en question de l unicité du système solaire
Dans la première moitié du XXe siècle, les estimations concernant le nombre de planètes dans la Voie lactée laissaient penser que notre système solaire pourrait être unique parmi environ 200 milliards d’étoiles.
Une idée qui bouleverse les paradigmes
Otto Struve est présenté comme le premier à bouleverser ces idées. En 1952, il publie une lettre de deux pages montrant que l effondrement d un nuage de gaz pour former une étoile entraîne une accélération de la rotation, comme une danseuse qui tourne sur elle-même. L étoile devrait tourner très vite… mais le Soleil et d autres étoiles montrent un rythme plus modeste. Il en déduit que le moment angulaire s est échappé dans un disque de gaz et de poussière en rotation rapide, un lieu propice à la formation de planètes.
La perspective de Struve est considérée comme une rupture majeure : les systèmes planétaires apparaissent comme des sous-produits obligatoires de la formation des étoiles. Selon Michel Mayor, cela impliquait que des milliards de planètes pourraient exister dans la Galaxie et que l exploration exoplanétaire allait devenir une priorité.
A partir de ce papier, l objectif n est plus seulement d observer les étoiles, mais de détecter directement ces exoplanètes.
La conférence de 1985 et l émergence de la méthode des vitesses radiales
Le souvenir d une conférence donnée dans l État de New York en 1985, dédiée aux vitesses radiales et à la technique qui mènera à la découverte de 51 Pegasi b, est évoqué par Michel Mayor. « Nous étions une dizaine de groupes à l utiliser à l époque, et seuls cinq ont donné lieu à des mesures réelles », rappelle-t-il.
La quête de 51 Pegasi b démarre
Un télescope modeste de 1,93 m équipé du spectrographe ELODIE est installé à l Observatoire de Haute-Provence et devient l instrument clé de cette recherche. Didier Queloz, doctorant de Mayor, participe aussi à ce travail révolutionnaire.
En 1993, le CNRS accorde du temps pour étudier 142 cibles jugées les plus prometteuses: « On a eu les 42 nuits que j avais demandées », se souvient Mayor. Cela équivaut à environ une semaine d observation toutes les deux semaines.
Une planète détectée en quelques mois
Au début de 1995, Michel Mayor travaille sur un télescope situé sur le Mauna Kea à Hawaii, pour détecter de petits compagnons d étoile. Pendant ce temps, Queloz poursuit les relevés en Provence et, en février, envoie un fax signalant des variations périodiques sur l étoile 51 Pegasi qui pourraient indiquer la présence d une planète. Il précise que cela pourrait aussi résulter d un champ magnétique ou d une pulsation, et qu aucune explication unique ne serait suffisante.
À la reprise des observations en juillet, les mesures complémentaires excluent les autres causes et confirment l hypothèse planétaire : chaque nuit, la vitesse mesurée s alignait sur la prédiction faite plusieurs mois plus tôt.
51 Pegasi b : une Jupiter chaude et une nouvelle catégorie
Située à environ 50 années-lumière dans la constellation du Pégase, 51 Pegasi b est une géante gazeuse représentant environ la moitié de la masse de Jupiter et affichant une température d environ mille degrés.
Cette découverte ouvre la catégorie des Jupiter chaudes, des planètes géantes orbitant très près de leur étoile.
Publication et annonce officielle
L article original, intitulé A Jupiter-mass companion to a solar-type star, est soumis à Nature et publié en novembre 1995. L annonce officielle intervient un mois plus tôt, lors d un workshop à Florence, devant près de 300 astronomes. Nature exige le respect de l embargo et les médias ne sont pas informés avant la publication.
Un prix Nobel et un héritage durable
Quatre ans plus tard, en 2019, Michel Mayor et Didier Queloz reçoivent conjointement le prix Nobel de physique pour la découverte d une exoplanète orbitant une étoile de type solaire. Le comité rappelle leurs contributions à la compréhension de l évolution de l Univers et de la place de la Terre dans le Cosmos.
Les réactions des deux chercheurs témoignent d un mélange de joie et de surprise : Mayor évoque une nomination longtemps tenue secrète et Queloz raconte avoir été pris par surprise par l annonce, alors qu il était en déplacement.
Héritage durable
En 2021, le chemin des Maillettes menant à l Observatoire de Genève est renommé chemin Pegasi en hommage à cette découverte et à l étoile hôte, marquant l impact durable de cette avancée sur la communauté scientifique et sur la vulgarisation de l astronomie.